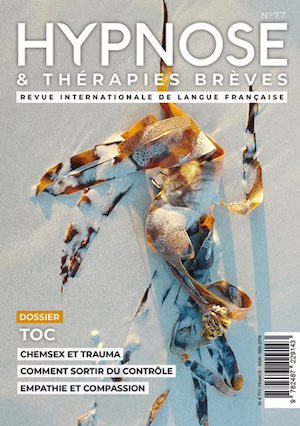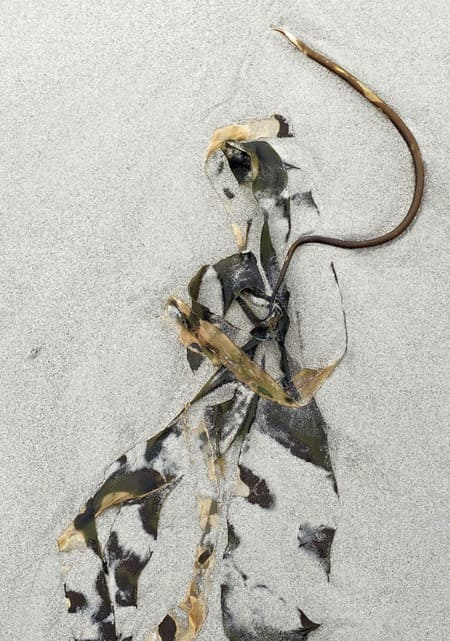
Anne DAYOT
Sophie, Laura, Alexandre et Marie. Quatre patients et autant de cas d’étude qui nous plongent dans le monde complexe et chaotique des TOC. Parmi les facteurs favorisant ces troubles : pressions sociales, quête de la perfection, exigences envers les proches, peur de l’échec... avec pour effet le déclenchement de toutes sortes de rituels compulsifs.
Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) constituent une pathologie mentale complexe qui touche une proportion significative de la population mondiale. La prévalence de ces troubles semble en hausse, particulièrement dans les sociétés modernes où les pressions sociales et culturelles peuvent exacerber leur développement. Comme le montre le cas de Sophie exposé ci-dessous, des facteurs sociaux contribuent à la recrudescence des TOC dans une société prônant la perfection des corps et la réussite. On remarque ainsi que les personnes atteintes de TOC ont souvent du mal à accepter l’imperfection, tant dans leur propre vie que dans celle des autres. Cette intolérance à l’imperfection peut alimenter des obsessions et des rituels compulsifs. Des études indiquent que les patients souffrant de TOC présentent souvent des biais métacognitifs, comme la fusion pensée-action morale (Frontiers, 2024). Regardons de plus près pour comprendre les mécanismes psychologiques sous-jacents.
ÉTUDE DE CAS : SOPHIE,UNE JEUNE PROFESSIONNELLE DANS UNE GRANDE VILLE
Sophie a 28 ans. Elle vient consulter à la clinique des TOC (1). Depuis un an, elle travaille comme analyste financière dans une grande ville. Elle a toujours été une élève brillante et a réussi avec succès ses études universitaires dans une école de commerce prestigieuse. Mais depuis qu’elle a commencé à travailler, elle ressent une pression immense pour exceller dans son travail. Sophie vit seule dans un appartement qu’elle a récemment acheté et passe la plupart de son temps à travailler, souvent tard dans la nuit.
Symptômes et comportements
Depuis quelques mois, Sophie a remarqué une augmentation de son anxiété. Elle est constamment préoccupée par l’idée de faire des erreurs au travail et vérifie à plusieurs reprises ses calculs et rapports, même après les avoir revérifiés plusieurs fois. Et peu à peu, cette angoisse de l’imperfection a gagné tous les domaines de sa vie. A la maison, par exemple, elle se sent obligée de vérifier que toutes les portes et fenêtres sont fermées plusieurs fois avant de pouvoir se coucher. Elle passe également une quantité excessive de temps à nettoyer et à organiser son espace de vie, craignant que tout désordre ne reflète une incapacité à contrôler sa vie.
En interrogeant son environnement, plusieurs facteurs sociaux apparaissent nettement. Sophie ressent une pression intense pour être performante et compétente dans son travail. L’environnement compétitif de son entreprise, combiné à une culture de l’excellence continue, augmente son anxiété et contribue à ses comportements compulsifs. Les réseaux sociaux influencent également son anxiété. Lorsqu’elle n’est pas au travail, Sophie passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, où elle voit constamment des images de ses collègues et amis qui semblent réussir parfaitement dans tous les aspects de leur vie. Cela renforce son sentiment de ne jamais en faire assez et son besoin de perfectionnisme.
En vivant seule et en consacrant la majorité de son temps au travail, Sophie se retrouve souvent isolée socialement. Ce manque de soutien social et d’interactions humaines significatives contribue à intensifier ses sentiments d’anxiété et ses comportements obsessionnels.
Processus psychologiques sous-jacents
Un perfectionnisme maladaptatif : Sophie souffre d’un perfectionnisme maladaptatif, croyant que tout écart par rapport à la perfection pourrait entraîner des conséquences négatives majeures, comme perdre son emploi ou être mal vue par ses collègues.
Un besoin de contrôle : pour Sophie, les rituels compulsifs (vérifications répétées, nettoyage excessif) sont une manière de gérer son anxiété. En contrôlant minutieusement certains aspects de sa vie, elle cherche à compenser un sentiment d’incertitude ou de perte de contrôle perçu dans d’autres domaines, comme au travail.
Un renforcement négatif : les comportements compulsifs de Sophie sont renforcés par une réduction temporaire de son anxiété. Par exemple, vérifier plusieurs fois que la porte est verrouillée réduit momentanément son inquiétude, ce qui renforce la probabilité qu’elle répète ce comportement.
Intervention et résultats
À travers des tâches comme « comment aggraver ? », « mettre un peu de désordre » et « faire un peu moins bien », Sophie apprend à identifier et à challenger ses pensées perfectionnistes et catastrophistes.
Prévalence et âge d’apparition
Chez les personnes recherchant un traitement pour les TOC, l’âge d’apparition des symptômes semble légèrement plus précoce chez les hommes que chez les femmes. Une étude par Lensi et al. en 1996 a rapporté que l’âge moyen d’apparition chez les hommes est de 21 ans et de 24 ans chez les femmes. Ces études montrent également que les symptômes apparaissent souvent avant l’âge de 15 ans pour environ un tiers des patients et avant 25 ans pour environ deux tiers d’entre eux.
Facteurs déclenchants et comorbidités
Plusieurs facteurs environnementaux peuvent déclencher les TOC. Rasmussen et Eisen (1988) ont mesuré que 29 % des patients attribuaient le début de leurs symptômes à des événements stressants tels que des responsabilités accrues ou des pertes importantes. De plus, une étude de Williams et Koran en 1997 a révélé que 62 % des femmes interrogées rapportaient une aggravation des symptômes prémenstruels.
Les TOC sont souvent associés à d’autres troubles mentaux. Une étude sur 100 patients souffrant de TOC a révélé une comorbidité élevée avec la dépression majeure (31 %), la phobie sociale (11 %) et les troubles
de l’alimentation (8 %). Cette comorbidité complique la prise en charge des patients et affecte négativement leur qualité de vie.
Impact sur la qualité de vie et le fonctionnement social
Les TOC altèrent significativement la qualité de vie des patients. Une étude menée par Koran, Thienemann et Davenport en 1996 a montré que les patients souffrant de TOC modérés à sévères et ne prenant pas de médicaments avaient des performances sociales et professionnelles inférieures à celles de la population générale et des patients diabétiques. Les TOC peuvent également entraîner des problèmes relationnels, une perte de vie sociale et des difficultés à maintenir des relations amoureuses.
Normes sociales et pression de réussite
Les sociétés modernes imposent souvent des normes élevées de réussite, de perfection et de conformité. Cette pression constante pour atteindre des objectifs irréalistes et inaccessibles peut conduire à un sentiment d’incapacité et d’insatisfaction, contribuant ainsi au développement des TOC. Les individus peuvent recourir à des comportements obsessionnels-compulsifs pour tenter de répondre à ces attentes irréalistes. Selon l’OCD-UK, les attentes sociales, en particu lier celles promues par les médias et la culture populaire, peuvent exacerber les symptômes des TOC en alimentant des standards inatteignables de perfection personnelle (OCDUK).
Des recherches montrent que les normes sociétales influencent la perception de soi et des autres, contribuant à des croyances rigides sur l’apparence physique et la perfection. Cette influence peut conduire à l’apparition de troubles obsessionnels, tels que le trouble dysmorphique corporel, où l’individu développe une obsession malsaine pour des défauts mineurs ou imaginaires de son apparence (MentalHelp.net).
Une société de la perfection :
influence des médias et des réseaux sociaux Les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la propagation du perfectionnisme. Les plateformes comme Instagram, Facebook et LinkedIn sont inondées d’images de réussite personnelle et professionnelle, de corps parfaits, et de vies apparemment sans défauts. Cette exposition constante à des standards inatteignables crée une pression pour se conformer à ces idéaux. Une étude publiée par le Journal of Social and Clinical Psychology indique que l’utilisation des réseaux sociaux est corrélée à des niveaux
accrus de perfectionnisme et d’anxiété chez les jeunes adultes. Le cas de Laura illustre parfaitement comment cet « effet de miroir social » où les individus comparent leur propre vie à celle, filtrée et souvent embellie, des autres conduit à une vision déformée de la réalité, où les utilisateurs perçoivent leurs propres accomplissements comme insuffisants par rapport à ceux des autres.
ÉTUDE DE CAS : LAURA SUR INSTA
Laura est une utilisatrice active des réseaux sociaux. A 24 ans, elle passe en moyenne trois heures par jour sur Instagram. Elle utilise cette plateforme principalement pour rester en contact avec ses amis, suivre les actualités, et s’inspirer de personnes influentes dans son domaine professionnel. Cependant, au fil du temps, Laura a commencé à ressentir une pression croissante pour se conformer aux images et aux récits de réussite qu’elle voit en ligne.
Contexte et symptômes
Laura a toujours été une personne consciencieuse, soucieuse de bien faire, que ce soit dans ses études ou au travail. Cependant, depuis qu’elle a intensifié son utilisation des réseaux sociaux, elle remarque un changement dans sa perception de soi et dans ses attentes personnelles. Elle se compare constamment aux autres utilisateurs qui semblent mener des vies parfaites. Les photos de corps sculptés, de vacances de rêve et de réussites professionnelles étalées sur les réseaux sociaux ont fait naître en elle un sentiment d’insatisfaction et d’inadéquation.
Elle commence à se fixer des objectifs irréalistes, tant sur le plan personnel que professionnel. Par exemple, elle se sent obligée de suivre un régime strict et de faire du sport tous les jours pour atteindre le « corps parfait » qu’elle voit sur Instagram. Professionnellement, elle est constamment à la recherche de nouvelles compétences à acquérir pour être à la hauteur des profils qu’elle voit. Cette quête incessante de la perfection entraîne chez elle un stress et une anxiété croissants.
Conséquences psychologiques et sociales
Les effets sur la santé mentale de Laura deviennent de plus en plus apparents. Elle commence à éprouver des sentiments d’anxiété avant de publier des photos ou des mises à jour de statut, craignant de ne pas recevoir suffisamment de « likes » ou de commentaires positifs. Cette peur du jugement et de l’échec contribue à son sentiment de ne jamais être « assez bien ». Sa vie sociale en pâtit également. Laura commence à éviter les rencontres avec ses amis, de peur d’être jugée sur son apparence ou ses accomplissements. Elle se sent déconnectée et isolée, même en présence de ses proches. Sa relation avec son partenaire souffre également, car elle se concentre davantage sur l’image qu’elle projette en ligne plutôt que sur ses interactions réelles.
Lorsque le thérapeute a demandé à Laura « comment aggraver ? », la jeune fille a hésité, puis elle a conclu : « Plus je regarde ces photos, plus je m’empoisonne. Et dire que la majorité des photos sont fausses ou retravaillées... » En se concentrant sur des activités qui lui apportent un vrai bonheur, comme la lecture, la promenade et le temps passé avec des amis proches, elle s’est remise dans la vie réelle et a réduit son temps en ligne. Après cinq séances, elle a reconnu commencer à se libérer de la pression du perfectionnisme.
Manifestations du perfectionnisme : comportements et attitudes
Bien que le perfectionnisme puisse initialement sembler bénéfique dans le milieu professionnel, il peut en réalité réduire la productivité et la satisfaction au travail. Les perfectionnistes peuvent passer un temps excessif sur des détails insignifiants, retardant ainsi l’achèvement des tâches importantes. De plus, leur insatisfaction constante face à leur performance peut entraîner un épuisement professionnel et une baisse de motivation. Dans ce cas, le perfectionnisme se manifeste par des comportements et des attitudes tels que la procrastination, la peur de l’échec et une autocritique sévère. Les perfectionnistes ont tendance à éviter les situations où ils pourraient échouer ou être perçus comme imparfaits. Cette peur de l’échec peut les conduire à procrastiner, car ils préfèrent remettre à plus tard une tâche plutôt que de risquer de ne pas la réaliser parfaitement. C’est le cas d’Alexandre, un jeune homme de 28 ans travaillant dans le domaine du marketing digital, piégé par la peur de l’échec.
ÉTUDE DE CAS : ALEXANDRE VEUT ÊTRE PARFAIT
Dès le début de sa carrière, Alexandre s’est fixé des standards extrêmement élevés, espérant se distinguer par son travail impeccable. Toutefois, ces attentes élevées se sont rapidement transformées en un piège, générant une peur paralysante de l’échec, une tendance à la procrastination, et une autocritique sévère.
Contexte
Alexandre est employé par une agence de marketing reconnue et travaille sur des projets de grande envergure pour des clients importants. Depuis son embauche, il se sent constamment sous pression pour exceller et produire un travail sans défaut. Il passe de longues heures à analyser chaque détail, revoyant sans cesse ses propositions et ses campagnes avant de les présenter. Malgré le fait que ses supérieurs aient déjà exprimé leur satisfaction quant à la qualité de son travail, Alexandre est toujours convaincu qu’il pourrait faire mieux. Or, cette obsession de la perfection commence à influencer son comportement au travail. Alexandre a peur de soumettre son travail tant qu’il ne le considère pas parfait, ce qui le pousse à retarder la soumission de ses projets. Par conséquent, il se retrouve souvent à travailler sous une pression accrue pour respecter les délais, ce qui entraîne du stress et de l’anxiété.
Effets psychologiques
Professionnellement, Alexandre commence à se sentir submergé par le volume de travail accumulé à cause de son besoin devenu obsessionnel et compulsif de tout vérifier. Ses collègues et supérieurs commencent à remarquer ses retards constants et, bien que la qualité de son travail soit excellente, le manque de respect des délais affecte la dynamique de l’équipe et le flux de travail de l’agence. A la maison, Alexandre se critique sévèrement pour son incapacité à gérer son temps et son travail de manière plus efficace. Il ressent un profond sentiment d’échec chaque fois qu’il réalise qu’il a encore une fois repoussé une tâche importante. Son autocritique devient un cycle vicieux : il se blâme de ne pouvoir être parfait, ce qui le pousse à vérifier encore plus et à être en incapacité de rendre son travail dans les temps impartis. Tout cela le pousse à éviter les tâches par peur de nouvelles déceptions. Cette situation a également des effets néfastes sur son bien-être émotionnel. Alexandre commence à ressentir des symptômes de stress et d’anxiété. Il a des difficultés à dormir, passe ses nuits à ressasser ses erreurs passées et à anticiper des critiques futures. Sa confiance en lui s’effrite progressivement, et il commence à douter de ses compétences et de sa valeur en tant que professionnel.
Le cas d’Alexandre illustre comment le perfectionnisme peut conduire à l’obsession, à l’épuisement et à une peur intense de l’échec. Son besoin de produire un travail parfait le paralyse au point de ne plus pouvoir agir, créant une spirale d’autocritique. Le perfectionnisme de ce type est souvent basé sur des croyances irrationnelles, comme l’idée que toute erreur est inacceptable ou que chaque tâche doit être réalisée sans aucun défaut. Le thérapeute a prescrit à Alexandre son symptôme : « Si tu vérifies une fois, tu dois le faire cinq fois » qui a saturé l’habitude dysfonctionnelle du jeune homme. Parallèlement, la prescription « afficher un petit défaut » lui a peu à peu permis de baisser son niveau d’exigence. En apprenant à accepter l’imperfection comme une partie naturelle du processus créatif et professionnel, il a surmonté ses tendances perfectionnistes. Il en rit aujourd’hui.
Relations interpersonnelles
Dans les relations interpersonnelles, le perfectionnisme peut conduire à des attentes irréalistes envers les autres, entraînant des conflits et des déceptions. Les perfectionnistes peuvent également éprouver des difficultés à exprimer leurs émotions et à demander de l’aide, de peur de paraître faibles ou imparfaits. Prenons le cas de Marie, une femme de 32 ans travaillant dans le secteur de la finance, dont le perfectionnisme influence non seulement sa propre vie, mais aussi ses relations avec les autres. En appliquant ses attentes très élevées envers les personnes qui l’entourent, Marie est souvent confrontée à des conflits et des frustrations.
ÉTUDE DE CAS : MARIE ET LA TYRANNIE DE LA PERFECTION
Marie est en couple avec Julien depuis cinq ans. Ils ont une relation généralement stable, mais Marie a tendance à s’attendre à ce que Julien se conforme à ses standards élevés, que ce soit dans la gestion des tâches ménagères ou dans la manière dont il organise sa vie professionnelle et personnelle. Par exemple, elle insiste pour que tout soit rangé de manière impeccable dans leur maison et se montre critique lorsque Julien ne suit pas ses méthodes. Marie exprime rarement ses émotions de manière ouverte, de peur d’être perçue comme vulnérable ou imparfaite. Elle pense que demander de l’aide ou montrer ses faiblesses serait un signe de faiblesse, ce qui la conduit à refouler ses sentiments et à accumuler du ressentiment. Cela rend la communication difficile dans leur relation, car Julien ne sait souvent pas ce que Marie pense ou ressent vraiment...
Pour lire la suite...
Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) constituent une pathologie mentale complexe qui touche une proportion significative de la population mondiale. La prévalence de ces troubles semble en hausse, particulièrement dans les sociétés modernes où les pressions sociales et culturelles peuvent exacerber leur développement. Comme le montre le cas de Sophie exposé ci-dessous, des facteurs sociaux contribuent à la recrudescence des TOC dans une société prônant la perfection des corps et la réussite. On remarque ainsi que les personnes atteintes de TOC ont souvent du mal à accepter l’imperfection, tant dans leur propre vie que dans celle des autres. Cette intolérance à l’imperfection peut alimenter des obsessions et des rituels compulsifs. Des études indiquent que les patients souffrant de TOC présentent souvent des biais métacognitifs, comme la fusion pensée-action morale (Frontiers, 2024). Regardons de plus près pour comprendre les mécanismes psychologiques sous-jacents.
ÉTUDE DE CAS : SOPHIE,UNE JEUNE PROFESSIONNELLE DANS UNE GRANDE VILLE
Sophie a 28 ans. Elle vient consulter à la clinique des TOC (1). Depuis un an, elle travaille comme analyste financière dans une grande ville. Elle a toujours été une élève brillante et a réussi avec succès ses études universitaires dans une école de commerce prestigieuse. Mais depuis qu’elle a commencé à travailler, elle ressent une pression immense pour exceller dans son travail. Sophie vit seule dans un appartement qu’elle a récemment acheté et passe la plupart de son temps à travailler, souvent tard dans la nuit.
Symptômes et comportements
Depuis quelques mois, Sophie a remarqué une augmentation de son anxiété. Elle est constamment préoccupée par l’idée de faire des erreurs au travail et vérifie à plusieurs reprises ses calculs et rapports, même après les avoir revérifiés plusieurs fois. Et peu à peu, cette angoisse de l’imperfection a gagné tous les domaines de sa vie. A la maison, par exemple, elle se sent obligée de vérifier que toutes les portes et fenêtres sont fermées plusieurs fois avant de pouvoir se coucher. Elle passe également une quantité excessive de temps à nettoyer et à organiser son espace de vie, craignant que tout désordre ne reflète une incapacité à contrôler sa vie.
En interrogeant son environnement, plusieurs facteurs sociaux apparaissent nettement. Sophie ressent une pression intense pour être performante et compétente dans son travail. L’environnement compétitif de son entreprise, combiné à une culture de l’excellence continue, augmente son anxiété et contribue à ses comportements compulsifs. Les réseaux sociaux influencent également son anxiété. Lorsqu’elle n’est pas au travail, Sophie passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, où elle voit constamment des images de ses collègues et amis qui semblent réussir parfaitement dans tous les aspects de leur vie. Cela renforce son sentiment de ne jamais en faire assez et son besoin de perfectionnisme.
En vivant seule et en consacrant la majorité de son temps au travail, Sophie se retrouve souvent isolée socialement. Ce manque de soutien social et d’interactions humaines significatives contribue à intensifier ses sentiments d’anxiété et ses comportements obsessionnels.
Processus psychologiques sous-jacents
Un perfectionnisme maladaptatif : Sophie souffre d’un perfectionnisme maladaptatif, croyant que tout écart par rapport à la perfection pourrait entraîner des conséquences négatives majeures, comme perdre son emploi ou être mal vue par ses collègues.
Un besoin de contrôle : pour Sophie, les rituels compulsifs (vérifications répétées, nettoyage excessif) sont une manière de gérer son anxiété. En contrôlant minutieusement certains aspects de sa vie, elle cherche à compenser un sentiment d’incertitude ou de perte de contrôle perçu dans d’autres domaines, comme au travail.
Un renforcement négatif : les comportements compulsifs de Sophie sont renforcés par une réduction temporaire de son anxiété. Par exemple, vérifier plusieurs fois que la porte est verrouillée réduit momentanément son inquiétude, ce qui renforce la probabilité qu’elle répète ce comportement.
Intervention et résultats
À travers des tâches comme « comment aggraver ? », « mettre un peu de désordre » et « faire un peu moins bien », Sophie apprend à identifier et à challenger ses pensées perfectionnistes et catastrophistes.
Prévalence et âge d’apparition
Chez les personnes recherchant un traitement pour les TOC, l’âge d’apparition des symptômes semble légèrement plus précoce chez les hommes que chez les femmes. Une étude par Lensi et al. en 1996 a rapporté que l’âge moyen d’apparition chez les hommes est de 21 ans et de 24 ans chez les femmes. Ces études montrent également que les symptômes apparaissent souvent avant l’âge de 15 ans pour environ un tiers des patients et avant 25 ans pour environ deux tiers d’entre eux.
Facteurs déclenchants et comorbidités
Plusieurs facteurs environnementaux peuvent déclencher les TOC. Rasmussen et Eisen (1988) ont mesuré que 29 % des patients attribuaient le début de leurs symptômes à des événements stressants tels que des responsabilités accrues ou des pertes importantes. De plus, une étude de Williams et Koran en 1997 a révélé que 62 % des femmes interrogées rapportaient une aggravation des symptômes prémenstruels.
Les TOC sont souvent associés à d’autres troubles mentaux. Une étude sur 100 patients souffrant de TOC a révélé une comorbidité élevée avec la dépression majeure (31 %), la phobie sociale (11 %) et les troubles
de l’alimentation (8 %). Cette comorbidité complique la prise en charge des patients et affecte négativement leur qualité de vie.
Impact sur la qualité de vie et le fonctionnement social
Les TOC altèrent significativement la qualité de vie des patients. Une étude menée par Koran, Thienemann et Davenport en 1996 a montré que les patients souffrant de TOC modérés à sévères et ne prenant pas de médicaments avaient des performances sociales et professionnelles inférieures à celles de la population générale et des patients diabétiques. Les TOC peuvent également entraîner des problèmes relationnels, une perte de vie sociale et des difficultés à maintenir des relations amoureuses.
Normes sociales et pression de réussite
Les sociétés modernes imposent souvent des normes élevées de réussite, de perfection et de conformité. Cette pression constante pour atteindre des objectifs irréalistes et inaccessibles peut conduire à un sentiment d’incapacité et d’insatisfaction, contribuant ainsi au développement des TOC. Les individus peuvent recourir à des comportements obsessionnels-compulsifs pour tenter de répondre à ces attentes irréalistes. Selon l’OCD-UK, les attentes sociales, en particu lier celles promues par les médias et la culture populaire, peuvent exacerber les symptômes des TOC en alimentant des standards inatteignables de perfection personnelle (OCDUK).
Des recherches montrent que les normes sociétales influencent la perception de soi et des autres, contribuant à des croyances rigides sur l’apparence physique et la perfection. Cette influence peut conduire à l’apparition de troubles obsessionnels, tels que le trouble dysmorphique corporel, où l’individu développe une obsession malsaine pour des défauts mineurs ou imaginaires de son apparence (MentalHelp.net).
Une société de la perfection :
influence des médias et des réseaux sociaux Les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la propagation du perfectionnisme. Les plateformes comme Instagram, Facebook et LinkedIn sont inondées d’images de réussite personnelle et professionnelle, de corps parfaits, et de vies apparemment sans défauts. Cette exposition constante à des standards inatteignables crée une pression pour se conformer à ces idéaux. Une étude publiée par le Journal of Social and Clinical Psychology indique que l’utilisation des réseaux sociaux est corrélée à des niveaux
accrus de perfectionnisme et d’anxiété chez les jeunes adultes. Le cas de Laura illustre parfaitement comment cet « effet de miroir social » où les individus comparent leur propre vie à celle, filtrée et souvent embellie, des autres conduit à une vision déformée de la réalité, où les utilisateurs perçoivent leurs propres accomplissements comme insuffisants par rapport à ceux des autres.
ÉTUDE DE CAS : LAURA SUR INSTA
Laura est une utilisatrice active des réseaux sociaux. A 24 ans, elle passe en moyenne trois heures par jour sur Instagram. Elle utilise cette plateforme principalement pour rester en contact avec ses amis, suivre les actualités, et s’inspirer de personnes influentes dans son domaine professionnel. Cependant, au fil du temps, Laura a commencé à ressentir une pression croissante pour se conformer aux images et aux récits de réussite qu’elle voit en ligne.
Contexte et symptômes
Laura a toujours été une personne consciencieuse, soucieuse de bien faire, que ce soit dans ses études ou au travail. Cependant, depuis qu’elle a intensifié son utilisation des réseaux sociaux, elle remarque un changement dans sa perception de soi et dans ses attentes personnelles. Elle se compare constamment aux autres utilisateurs qui semblent mener des vies parfaites. Les photos de corps sculptés, de vacances de rêve et de réussites professionnelles étalées sur les réseaux sociaux ont fait naître en elle un sentiment d’insatisfaction et d’inadéquation.
Elle commence à se fixer des objectifs irréalistes, tant sur le plan personnel que professionnel. Par exemple, elle se sent obligée de suivre un régime strict et de faire du sport tous les jours pour atteindre le « corps parfait » qu’elle voit sur Instagram. Professionnellement, elle est constamment à la recherche de nouvelles compétences à acquérir pour être à la hauteur des profils qu’elle voit. Cette quête incessante de la perfection entraîne chez elle un stress et une anxiété croissants.
Conséquences psychologiques et sociales
Les effets sur la santé mentale de Laura deviennent de plus en plus apparents. Elle commence à éprouver des sentiments d’anxiété avant de publier des photos ou des mises à jour de statut, craignant de ne pas recevoir suffisamment de « likes » ou de commentaires positifs. Cette peur du jugement et de l’échec contribue à son sentiment de ne jamais être « assez bien ». Sa vie sociale en pâtit également. Laura commence à éviter les rencontres avec ses amis, de peur d’être jugée sur son apparence ou ses accomplissements. Elle se sent déconnectée et isolée, même en présence de ses proches. Sa relation avec son partenaire souffre également, car elle se concentre davantage sur l’image qu’elle projette en ligne plutôt que sur ses interactions réelles.
Lorsque le thérapeute a demandé à Laura « comment aggraver ? », la jeune fille a hésité, puis elle a conclu : « Plus je regarde ces photos, plus je m’empoisonne. Et dire que la majorité des photos sont fausses ou retravaillées... » En se concentrant sur des activités qui lui apportent un vrai bonheur, comme la lecture, la promenade et le temps passé avec des amis proches, elle s’est remise dans la vie réelle et a réduit son temps en ligne. Après cinq séances, elle a reconnu commencer à se libérer de la pression du perfectionnisme.
Manifestations du perfectionnisme : comportements et attitudes
Bien que le perfectionnisme puisse initialement sembler bénéfique dans le milieu professionnel, il peut en réalité réduire la productivité et la satisfaction au travail. Les perfectionnistes peuvent passer un temps excessif sur des détails insignifiants, retardant ainsi l’achèvement des tâches importantes. De plus, leur insatisfaction constante face à leur performance peut entraîner un épuisement professionnel et une baisse de motivation. Dans ce cas, le perfectionnisme se manifeste par des comportements et des attitudes tels que la procrastination, la peur de l’échec et une autocritique sévère. Les perfectionnistes ont tendance à éviter les situations où ils pourraient échouer ou être perçus comme imparfaits. Cette peur de l’échec peut les conduire à procrastiner, car ils préfèrent remettre à plus tard une tâche plutôt que de risquer de ne pas la réaliser parfaitement. C’est le cas d’Alexandre, un jeune homme de 28 ans travaillant dans le domaine du marketing digital, piégé par la peur de l’échec.
ÉTUDE DE CAS : ALEXANDRE VEUT ÊTRE PARFAIT
Dès le début de sa carrière, Alexandre s’est fixé des standards extrêmement élevés, espérant se distinguer par son travail impeccable. Toutefois, ces attentes élevées se sont rapidement transformées en un piège, générant une peur paralysante de l’échec, une tendance à la procrastination, et une autocritique sévère.
Contexte
Alexandre est employé par une agence de marketing reconnue et travaille sur des projets de grande envergure pour des clients importants. Depuis son embauche, il se sent constamment sous pression pour exceller et produire un travail sans défaut. Il passe de longues heures à analyser chaque détail, revoyant sans cesse ses propositions et ses campagnes avant de les présenter. Malgré le fait que ses supérieurs aient déjà exprimé leur satisfaction quant à la qualité de son travail, Alexandre est toujours convaincu qu’il pourrait faire mieux. Or, cette obsession de la perfection commence à influencer son comportement au travail. Alexandre a peur de soumettre son travail tant qu’il ne le considère pas parfait, ce qui le pousse à retarder la soumission de ses projets. Par conséquent, il se retrouve souvent à travailler sous une pression accrue pour respecter les délais, ce qui entraîne du stress et de l’anxiété.
Effets psychologiques
Professionnellement, Alexandre commence à se sentir submergé par le volume de travail accumulé à cause de son besoin devenu obsessionnel et compulsif de tout vérifier. Ses collègues et supérieurs commencent à remarquer ses retards constants et, bien que la qualité de son travail soit excellente, le manque de respect des délais affecte la dynamique de l’équipe et le flux de travail de l’agence. A la maison, Alexandre se critique sévèrement pour son incapacité à gérer son temps et son travail de manière plus efficace. Il ressent un profond sentiment d’échec chaque fois qu’il réalise qu’il a encore une fois repoussé une tâche importante. Son autocritique devient un cycle vicieux : il se blâme de ne pouvoir être parfait, ce qui le pousse à vérifier encore plus et à être en incapacité de rendre son travail dans les temps impartis. Tout cela le pousse à éviter les tâches par peur de nouvelles déceptions. Cette situation a également des effets néfastes sur son bien-être émotionnel. Alexandre commence à ressentir des symptômes de stress et d’anxiété. Il a des difficultés à dormir, passe ses nuits à ressasser ses erreurs passées et à anticiper des critiques futures. Sa confiance en lui s’effrite progressivement, et il commence à douter de ses compétences et de sa valeur en tant que professionnel.
Le cas d’Alexandre illustre comment le perfectionnisme peut conduire à l’obsession, à l’épuisement et à une peur intense de l’échec. Son besoin de produire un travail parfait le paralyse au point de ne plus pouvoir agir, créant une spirale d’autocritique. Le perfectionnisme de ce type est souvent basé sur des croyances irrationnelles, comme l’idée que toute erreur est inacceptable ou que chaque tâche doit être réalisée sans aucun défaut. Le thérapeute a prescrit à Alexandre son symptôme : « Si tu vérifies une fois, tu dois le faire cinq fois » qui a saturé l’habitude dysfonctionnelle du jeune homme. Parallèlement, la prescription « afficher un petit défaut » lui a peu à peu permis de baisser son niveau d’exigence. En apprenant à accepter l’imperfection comme une partie naturelle du processus créatif et professionnel, il a surmonté ses tendances perfectionnistes. Il en rit aujourd’hui.
Relations interpersonnelles
Dans les relations interpersonnelles, le perfectionnisme peut conduire à des attentes irréalistes envers les autres, entraînant des conflits et des déceptions. Les perfectionnistes peuvent également éprouver des difficultés à exprimer leurs émotions et à demander de l’aide, de peur de paraître faibles ou imparfaits. Prenons le cas de Marie, une femme de 32 ans travaillant dans le secteur de la finance, dont le perfectionnisme influence non seulement sa propre vie, mais aussi ses relations avec les autres. En appliquant ses attentes très élevées envers les personnes qui l’entourent, Marie est souvent confrontée à des conflits et des frustrations.
ÉTUDE DE CAS : MARIE ET LA TYRANNIE DE LA PERFECTION
Marie est en couple avec Julien depuis cinq ans. Ils ont une relation généralement stable, mais Marie a tendance à s’attendre à ce que Julien se conforme à ses standards élevés, que ce soit dans la gestion des tâches ménagères ou dans la manière dont il organise sa vie professionnelle et personnelle. Par exemple, elle insiste pour que tout soit rangé de manière impeccable dans leur maison et se montre critique lorsque Julien ne suit pas ses méthodes. Marie exprime rarement ses émotions de manière ouverte, de peur d’être perçue comme vulnérable ou imparfaite. Elle pense que demander de l’aide ou montrer ses faiblesses serait un signe de faiblesse, ce qui la conduit à refouler ses sentiments et à accumuler du ressentiment. Cela rend la communication difficile dans leur relation, car Julien ne sait souvent pas ce que Marie pense ou ressent vraiment...
Pour lire la suite...
Grégoire Vitry
PhD, systémicien, formateur, directeur et associé de LACT, directeur de SYPRENE. Docteur-chercheur en psychologie, diplômé de l’école de Palo Alto.
Travaille depuis plusieurs années avec Giorgio Nardone, Nathalie Duriez, Michael Hoyt, Teresa Garcia, Jean-Jacques Wittezaele, Wendel Ray et le MRI afin de promouvoir la recherche et la formation en approche systémique.
Il développe depuis 2016 SYPRENE, un réseau PRN (Vitry et al., 2021, 2022, 2023) en approche systémique permettant notamment d’améliorer sa pratique en étroite collaboration avec le monde universitaire. Il est également en charge de l’école internationale LACT et du congrès International Webinar Brief Therapy.
Auteur, coauteur ou directeur des ouvrages : Quand le travail fait mal, Stratégies de changement : 16 prescriptions thérapeutiques, Comprendre et soigner les addictions, Sortir de l’addiction ?, La thérapie brève systémique stratégique, Le grand livre du diagnostic systémique et de l’intervention stratégique.
Travaille depuis plusieurs années avec Giorgio Nardone, Nathalie Duriez, Michael Hoyt, Teresa Garcia, Jean-Jacques Wittezaele, Wendel Ray et le MRI afin de promouvoir la recherche et la formation en approche systémique.
Il développe depuis 2016 SYPRENE, un réseau PRN (Vitry et al., 2021, 2022, 2023) en approche systémique permettant notamment d’améliorer sa pratique en étroite collaboration avec le monde universitaire. Il est également en charge de l’école internationale LACT et du congrès International Webinar Brief Therapy.
Auteur, coauteur ou directeur des ouvrages : Quand le travail fait mal, Stratégies de changement : 16 prescriptions thérapeutiques, Comprendre et soigner les addictions, Sortir de l’addiction ?, La thérapie brève systémique stratégique, Le grand livre du diagnostic systémique et de l’intervention stratégique.
Emmanuelle Gallin
Thérapeute systémicienne, chargée de recherche à LACT et doctorante en sciences de gestion à l’université de Limoges. Ses recherches portent sur le rôle des croyances dans le modèle de Palo Alto.
Professeur de yoga spécialisée dans la régulation des troubles sensoriels, elle est l’auteure de TSA, TED, TDAH, ce yoga est pour vous, coauteure du Grand livre de diagnostic systémique et de l’intervention stratégique, auteure également d’articles de recherche.
Professeur de yoga spécialisée dans la régulation des troubles sensoriels, elle est l’auteure de TSA, TED, TDAH, ce yoga est pour vous, coauteure du Grand livre de diagnostic systémique et de l’intervention stratégique, auteure également d’articles de recherche.

Revue Hypnose et Thérapies Brèves 77
N°77 : Mai / Juin / Juillet 2025
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce numéro :
Editorial : « L’empathie et la compassion comme fil d’or du soin » Julien Betbèze
8 / En couverture : Anne Dayot De sable et d’algues Sophie Cohen
10 / Désamorcer les traumas et se replacer dans l’existence par la Psychothérapie du Trauma Réassociative (PTR) Marine Manouvrier et Gérald Brassine
20 / Chemsex, trauma et EMDR-IMO . L’échelle de mesure « croire en moi » Sophie Tournouër
28 / Cothérapie avec Romain Faire émerger les relations sécures Jérémie Roos
36 / La voie métaphorique en « super-inter-vision ». Comment développer la créativité. des soignants Claire Conte-Rossin et Catherine Martin
ESPACE DOULEUR DOUCEUR
46 / Introduction Gérard Ostermann
50 / Empathie et compassion Deux forces pour soigner autrement Olivier de Palézieux
61 / INTERVIEW Mylène Blasco Propos recueillis par Gérard Ostermann
68 / DOSSIER TOC
70 / La société contemporaine : Perfection et fabrique des TOC Grégoire Vitry et Emmanuelle Gallin
82 / La pensée magique dans les TOC Typologie des rituels magiques Claude Michel
QUIPROQUO
98 / Les obsessions S. Colombo, Muhuc
BONJOUR ET APRÈS...
102 / André et son ventre Pour une séance plus qu’émouvante Sophie Cohen
LES CHAMPS DU POSSIBLE
106 / Se cogner au réel Adrian Chaboche
CULTURE MONDE
114 / Dans les sanctuaires du shintō Bruno Bréchemier
LIVRES EN BOUCHE
120 / J. Betbèze et S. Cohen
125 ESPACE FORMATIONS
Illustrations: Anne DAYOT
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce numéro :
Editorial : « L’empathie et la compassion comme fil d’or du soin » Julien Betbèze
8 / En couverture : Anne Dayot De sable et d’algues Sophie Cohen
10 / Désamorcer les traumas et se replacer dans l’existence par la Psychothérapie du Trauma Réassociative (PTR) Marine Manouvrier et Gérald Brassine
20 / Chemsex, trauma et EMDR-IMO . L’échelle de mesure « croire en moi » Sophie Tournouër
28 / Cothérapie avec Romain Faire émerger les relations sécures Jérémie Roos
36 / La voie métaphorique en « super-inter-vision ». Comment développer la créativité. des soignants Claire Conte-Rossin et Catherine Martin
ESPACE DOULEUR DOUCEUR
46 / Introduction Gérard Ostermann
50 / Empathie et compassion Deux forces pour soigner autrement Olivier de Palézieux
61 / INTERVIEW Mylène Blasco Propos recueillis par Gérard Ostermann
68 / DOSSIER TOC
70 / La société contemporaine : Perfection et fabrique des TOC Grégoire Vitry et Emmanuelle Gallin
82 / La pensée magique dans les TOC Typologie des rituels magiques Claude Michel
QUIPROQUO
98 / Les obsessions S. Colombo, Muhuc
BONJOUR ET APRÈS...
102 / André et son ventre Pour une séance plus qu’émouvante Sophie Cohen
LES CHAMPS DU POSSIBLE
106 / Se cogner au réel Adrian Chaboche
CULTURE MONDE
114 / Dans les sanctuaires du shintō Bruno Bréchemier
LIVRES EN BOUCHE
120 / J. Betbèze et S. Cohen
125 ESPACE FORMATIONS
Illustrations: Anne DAYOT