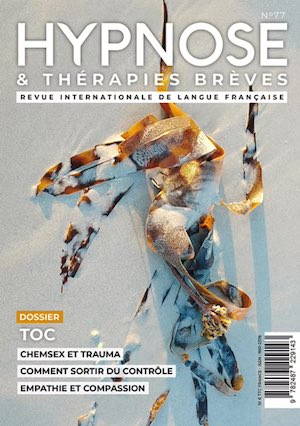Illustrations: Anne DAYOT
Pour découvrir le Japon, la meilleure approche est de lâcher le mental et s’ouvrir aux sensations, comme en hypnose. Il suffit de se poser, en silence, et se laisser imprégner par l’atmosphère des lieux, en particulier ceux qui semblent les plus mystérieux. Parmi eux, les sanctuaires shintō, appelés jinja en japonais. Le shintō (voie des dieux), religion autochtone propre à l’archipel, incarne l’âme la plus ancienne et profonde du Japon. Véritable socle culturel millénaire, il tisse un lien vivant entre le présent et les origines du pays. A la fois communion avec la nature, célébration de la vie et espace de régénération, le shintō entre en résonance avec les aspects les plus fondamentaux de l’hypnose.
A l’entrée du sanctuaire se dresse un grand portique, souvent rouge vermillon, l’une des images emblématiques du Japon. Il marque symboliquement la transition entre le monde extérieur et l’espace sacré. « Chaque visite d’un jinja est une expérience unique et inoubliable.
Comme en hypnose, où chaque séance, chaque transe, a ses propres caractéristiques, sa propre atmosphère, ses propres connexions multiples. En se promenant dans ces lieux à l’énergie profonde, où des cèdres souvent centenaires nous invitent dans leurs ombres mystérieuses, on entre dans une autre dimension, dans une transe (autohypnose) souvent surprenante. On ne peut alors que s’imprégner de la beauté des lieux, de leur silence si particulier » (1).
Cela fait écho à la construction du lieu ressource en hypnose, où l’on guide la personne vers la création d’un espace mental sécurisant, un sanctuaire intérieur. De la même manière, les sanctuaires naturels du shintō – forêts sacrées, sources limpides, cascades – rappellent certaines métaphores thérapeutiques couramment utilisées en hypnose : marcher dans une forêt intérieure, écouter le murmure d’une rivière imaginaire, ou se laisser envelopper par une cascade bienfaisante.
Dans le shintō, la connexion à la nature est essentielle pour préserver l’équilibre physique et mental. Se recueillir devant un arbre vénéré, se rendre dans un sanctuaire niché au cœur d’une forêt sacrée ou encore pratiquer le shinrin yoku (bain de forêt) sont autant de pratiques reconnues pour leurs bienfaits sur la santé. La vision japonaise du monde naturel ne repose pas sur un dualisme entre l’homme et son environnement, mais sur une relation intime, où humains et nature coexistent comme les membres d’une même grande famille. En hypnose, on observe combien la nature imprègne les perceptions des patients et joue un véritable rôle thérapeutique.
Les rituels de purification occupent une place importante dans le shintō. Ils visent à éliminer les impuretés (kegare) affectant l’équilibre physique, mental et spirituel. Dès l’entrée du sanctuaire, un bassin d’ablutions invite à un rituel codifié. Cette démarche trouve un parallèle en hypnothérapie lorsqu’au début de la séance on guide la personne à travers les couches du mental analytique, souvent agité, pour atteindre un état plus fluide, intuitif et profond. La purification par l’eau rappelle les inductions hypnotiques fondées sur des métaphores aquatiques, tandis que l’usage du sel ou du feu évoque certaines suggestions de purification par la lumière ou les flammes.
De nombreux sanctuaires shintō sont consacrés aux pratiques de guérison. Citons le Goō jinja (Kyōto), particulièrement fréquenté pour les prières liées à la guérison des blessures, et le Sai jinja (Nara) qui possède un puits contenant une eau médicinale utilisée dans certains traitements traditionnels. Lors de certaines
fêtes rituelles (matsuri), les prêtres récitent des prières adressées aux divinités pour éloigner la maladie et restaurer la vitalité. Ces cérémonies, rythmées par les tambours (taiko), la musique et la danse, représentent une forme de transe collective. Le Nagoshi no harae, en juin, est un rituel de purification où les participants traversent un grand cercle de paille pour se libérer des impuretés accumulées et renforcer leur énergie vitale.
Dans les sanctuaires, les fidèles accrochent des ema, petites plaques votives en bois, sur lesquelles ils inscrivent leurs prières et dessinent parfois la partie du corps à soigner pour guider l’aide des dieux. Ces plaques sont ensuite brûlées lors du dondoyaki, un festival du feu célébré mi-janvier dans tout le Japon, où l’on consume également les décorations du Nouvel An afin de symboliser un renouveau spirituel et de prier pour la prospérité de l’année à venir.
A travers ces rituels, le shintō illustre une approche holistique du soin, où le sacré et la guérison s’entrelacent dans une relation vivante entre l’homme et les forces spirituelles, les kami...
Pour lire la suite...
A l’entrée du sanctuaire se dresse un grand portique, souvent rouge vermillon, l’une des images emblématiques du Japon. Il marque symboliquement la transition entre le monde extérieur et l’espace sacré. « Chaque visite d’un jinja est une expérience unique et inoubliable.
Comme en hypnose, où chaque séance, chaque transe, a ses propres caractéristiques, sa propre atmosphère, ses propres connexions multiples. En se promenant dans ces lieux à l’énergie profonde, où des cèdres souvent centenaires nous invitent dans leurs ombres mystérieuses, on entre dans une autre dimension, dans une transe (autohypnose) souvent surprenante. On ne peut alors que s’imprégner de la beauté des lieux, de leur silence si particulier » (1).
Cela fait écho à la construction du lieu ressource en hypnose, où l’on guide la personne vers la création d’un espace mental sécurisant, un sanctuaire intérieur. De la même manière, les sanctuaires naturels du shintō – forêts sacrées, sources limpides, cascades – rappellent certaines métaphores thérapeutiques couramment utilisées en hypnose : marcher dans une forêt intérieure, écouter le murmure d’une rivière imaginaire, ou se laisser envelopper par une cascade bienfaisante.
Dans le shintō, la connexion à la nature est essentielle pour préserver l’équilibre physique et mental. Se recueillir devant un arbre vénéré, se rendre dans un sanctuaire niché au cœur d’une forêt sacrée ou encore pratiquer le shinrin yoku (bain de forêt) sont autant de pratiques reconnues pour leurs bienfaits sur la santé. La vision japonaise du monde naturel ne repose pas sur un dualisme entre l’homme et son environnement, mais sur une relation intime, où humains et nature coexistent comme les membres d’une même grande famille. En hypnose, on observe combien la nature imprègne les perceptions des patients et joue un véritable rôle thérapeutique.
Les rituels de purification occupent une place importante dans le shintō. Ils visent à éliminer les impuretés (kegare) affectant l’équilibre physique, mental et spirituel. Dès l’entrée du sanctuaire, un bassin d’ablutions invite à un rituel codifié. Cette démarche trouve un parallèle en hypnothérapie lorsqu’au début de la séance on guide la personne à travers les couches du mental analytique, souvent agité, pour atteindre un état plus fluide, intuitif et profond. La purification par l’eau rappelle les inductions hypnotiques fondées sur des métaphores aquatiques, tandis que l’usage du sel ou du feu évoque certaines suggestions de purification par la lumière ou les flammes.
De nombreux sanctuaires shintō sont consacrés aux pratiques de guérison. Citons le Goō jinja (Kyōto), particulièrement fréquenté pour les prières liées à la guérison des blessures, et le Sai jinja (Nara) qui possède un puits contenant une eau médicinale utilisée dans certains traitements traditionnels. Lors de certaines
fêtes rituelles (matsuri), les prêtres récitent des prières adressées aux divinités pour éloigner la maladie et restaurer la vitalité. Ces cérémonies, rythmées par les tambours (taiko), la musique et la danse, représentent une forme de transe collective. Le Nagoshi no harae, en juin, est un rituel de purification où les participants traversent un grand cercle de paille pour se libérer des impuretés accumulées et renforcer leur énergie vitale.
Dans les sanctuaires, les fidèles accrochent des ema, petites plaques votives en bois, sur lesquelles ils inscrivent leurs prières et dessinent parfois la partie du corps à soigner pour guider l’aide des dieux. Ces plaques sont ensuite brûlées lors du dondoyaki, un festival du feu célébré mi-janvier dans tout le Japon, où l’on consume également les décorations du Nouvel An afin de symboliser un renouveau spirituel et de prier pour la prospérité de l’année à venir.
A travers ces rituels, le shintō illustre une approche holistique du soin, où le sacré et la guérison s’entrelacent dans une relation vivante entre l’homme et les forces spirituelles, les kami...
Pour lire la suite...
Dr Bruno Bréchemier
Médecin, hypnothérapeute, à Paris. Formé à l’AFEHM, sa pratique clinique s’inscrit dans la lignée de François Roustang. Son intérêt pour
le Japon l’a amené à publier Hypnose-Japon. Rencontre en résonance (Satas, 2024) où l’hypnose thérapeutique rencontre la culture japonaise. Formateur en hypnose et en santé intégrative.
le Japon l’a amené à publier Hypnose-Japon. Rencontre en résonance (Satas, 2024) où l’hypnose thérapeutique rencontre la culture japonaise. Formateur en hypnose et en santé intégrative.
N°77 : Mai / Juin / Juillet 2025
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce numéro :
Editorial : « L’empathie et la compassion comme fil d’or du soin » Julien Betbèze
8 / En couverture : Anne Dayot De sable et d’algues Sophie Cohen
10 / Désamorcer les traumas et se replacer dans l’existence par la Psychothérapie du Trauma Réassociative (PTR) Marine Manouvrier et Gérald Brassine
20 / Chemsex, trauma et EMDR-IMO . L’échelle de mesure « croire en moi » Sophie Tournouër
28 / Cothérapie avec Romain Faire émerger les relations sécures Jérémie Roos
36 / La voie métaphorique en « super-inter-vision ». Comment développer la créativité. des soignants Claire Conte-Rossin et Catherine Martin
ESPACE DOULEUR DOUCEUR
46 / Introduction Gérard Ostermann
50 / Empathie et compassion Deux forces pour soigner autrement Olivier de Palézieux
61 / INTERVIEW Mylène Blasco Propos recueillis par Gérard Ostermann
68 / DOSSIER TOC
70 / La société contemporaine : Perfection et fabrique des TOC Grégoire Vitry et Emmanuelle Gallin
82 / La pensée magique dans les TOC Typologie des rituels magiques Claude Michel
QUIPROQUO
98 / Les obsessions S. Colombo, Muhuc
BONJOUR ET APRÈS...
102 / André et son ventre Pour une séance plus qu’émouvante Sophie Cohen
LES CHAMPS DU POSSIBLE
106 / Se cogner au réel Adrian Chaboche
CULTURE MONDE
114 / Dans les sanctuaires du shintō Bruno Bréchemier
LIVRES EN BOUCHE
120 / J. Betbèze et S. Cohen
125 ESPACE FORMATIONS
Illustrations: Anne DAYOT
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce numéro :
Editorial : « L’empathie et la compassion comme fil d’or du soin » Julien Betbèze
8 / En couverture : Anne Dayot De sable et d’algues Sophie Cohen
10 / Désamorcer les traumas et se replacer dans l’existence par la Psychothérapie du Trauma Réassociative (PTR) Marine Manouvrier et Gérald Brassine
20 / Chemsex, trauma et EMDR-IMO . L’échelle de mesure « croire en moi » Sophie Tournouër
28 / Cothérapie avec Romain Faire émerger les relations sécures Jérémie Roos
36 / La voie métaphorique en « super-inter-vision ». Comment développer la créativité. des soignants Claire Conte-Rossin et Catherine Martin
ESPACE DOULEUR DOUCEUR
46 / Introduction Gérard Ostermann
50 / Empathie et compassion Deux forces pour soigner autrement Olivier de Palézieux
61 / INTERVIEW Mylène Blasco Propos recueillis par Gérard Ostermann
68 / DOSSIER TOC
70 / La société contemporaine : Perfection et fabrique des TOC Grégoire Vitry et Emmanuelle Gallin
82 / La pensée magique dans les TOC Typologie des rituels magiques Claude Michel
QUIPROQUO
98 / Les obsessions S. Colombo, Muhuc
BONJOUR ET APRÈS...
102 / André et son ventre Pour une séance plus qu’émouvante Sophie Cohen
LES CHAMPS DU POSSIBLE
106 / Se cogner au réel Adrian Chaboche
CULTURE MONDE
114 / Dans les sanctuaires du shintō Bruno Bréchemier
LIVRES EN BOUCHE
120 / J. Betbèze et S. Cohen
125 ESPACE FORMATIONS
Illustrations: Anne DAYOT